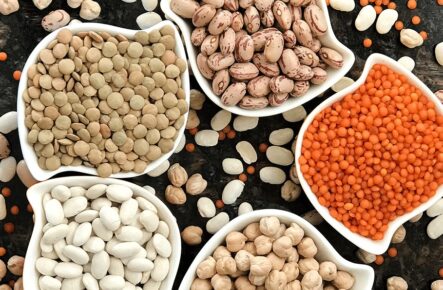- Entreprises étrangères tous secteurs confondus souhaitant se développer en Hauts-de-France
- Entreprises françaises n’ayant pas de site en Hauts-de-France
- Entreprises des Hauts-de-France ayant un enjeu de transmission
- Entreprises des Hauts-de-France détenues par des capitaux étrangers ayant un projet de développement
- Auto-entrepreneurs français ou internationaux
- Entreprises françaises souhaitant exporter
- Entreprises internationales cherchant uniquement des réseaux de distribution














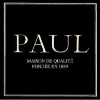





















 3400 m²
3400 m²